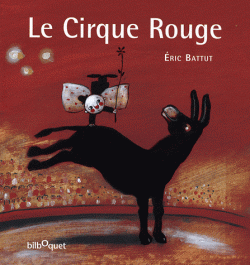Comme tout snob qui se respecte, je suis allé à la dernière exposition du musée du Luxembourg, en compagnie de la délicieuse amie que j’attendais devant le peintre et son double et nous eûmes ainsi l’occasion de nous extasier devant les toiles d’Arcimboldo, le peintre que l’on découvre au lycée en ricanant, en se disant « tiens c’est marrant » et dont on nous explique un peu plus tard que tout cela est décidément bien métaphysique.
Comme toute exposition du Luxembourg, il faut s’attendre à la fois à dépenser une fortune (9 euros pour les tarifs réduits) pour une visite somme toute assez éphémère, et à supporter les commentaires insipides doctement énoncés par quelque vieillarde autochtone, s’extasiant devant la « ligne » (sic !) d’Arcimboldo et moult autres atrocités du même acabit. De surcroît, le sens logique de la visite s’obstine à demeurer obscur : ni thématique, ni chronologique, on peine à comprendre exactement quelle se veut être la cohérence interne de l’ordre d’exposition, si ce n’est celle de disposer les toiles en fonction de la place qu’offre chacune des salles.
Toutefois, et la chose est suffisamment rare pour être soulignée, le Luxembourg propose l’essentiel des toiles majeures d’Arcimboldo et non une ou deux œuvres importantes, tant bien que mal meublées par d’inutiles apprêts comme ce fut le cas pour Botticelli ou Véronèse. Le catalogue en ligne du Sénat est à cet égard fort éloquent, et la qualité des œuvres exposées mérite très clairement le détour.
Ce que l’on peut dire, en règle très générale, sur la peintre d’Arcimboldo, c’est son caractère extraordinairement maniériste, chatoyant et, plus généralement grotesque ; Arcimboldo arrive à une époque où les grotesques, c’est-à-dire ces visages soit hideux soit hors du commun, ont constitué un exercice de style initié par Léonard de Vinci ; grâce à lui, on s’intéresse au hors-norme, au déroutant, et on ne recherche plus nécessairement l’idéal : la démesure maniériste s’exprime aussi bien dans le beau que dans le laid, sans qu’aucun impératif de vraisemblance ne demeure. On a souvent insisté sur le rôle qu’avait joué Berni dans ce décentrement des impératifs picturaux et il me semble que c’est tout à fait justifié ; l’anti-pétrarquisme joue ici au maximum contre l’idéal classique de modération ; tout se métaphorise, la joue est tomate, tandis que le front est melon. Cela choque, cela heurte, cela claque. « A la place d’une langue sélectionnée, écrit Antonio Pinelli, et délicate, il y a la violence picturale d’un dialecte très coloré et sans inhibitions, où la métaphore « élevée » est remplacée par une métaphore « basse » et dégradante, avec sa véhémence caricaturale et disgracieuse. »[1] On ne saurait mieux décrire l’art d’Arcimboldo.
Plastiquement, je ne crois pas que ce serait lui faire insulte que de rappeler à quel point sa maîtrise de la couleur et de la lumière outrepassent celle de son dessin ; Arcimboldo est un génie, un maître, un virtuose de la lumière, des ombres, à partir desquelles naissent les grotesques, des harmonies chromatiques d’où s’organise l’unité des portraits nonobstant la multiplicité des fruits qui les composent. Il est certain que chez lui la lumière et la couleur créent la forme, comme en témoigne, par exemple, le Printemps où, loin de tout contour, ce sont les nuances chromatiques qui dessinent ce que l’esprit identifie à une forme reconnaissable.
Parmi les toiles proposées, se trouve évidemment le cycle fort célèbre des saisons, dont le plus qu’intrigant Printemps. Chacun connaît l’importance thématique que le Printemps peut revêtir pour la Renaissance, auquel celle-ci avait pratiquement fini par s’identifier. Le choix arcimboldien du traitement de ce thème est plastiquement remarquable : symbole même de la Renaissance et du temps, la composition va se faire métonymie des quatre saisons elles-mêmes, et, par conséquent, se diviser en quatre. La chevelure, le visage, le col et le manteau composeront ainsi chacun un thème précis, distinct mais concourant à l’unité de l’ensemble par le thème floral. A chacune de ces parties correspond une composition différenciée, avec la juxtaposition linéaire des pâquerettes du col, créant au niveau médian de la toile une impression de rigueur linéaire, départageant de part et d’autre un visage sur lequel s’épanouissent des roses circulaires et étales, par lesquelles se répand une fraîcheur rosée surplombée par des boucles florales évoquant une chevelure abondante et foisonnante. En-deçà du col, c’est une toute autre composition qu’adopte Arcimboldo ; la ligne se fait verticale, si bien que le col acquiert un rôle tout à fait majeur : il me semble que la verticalité des fleurs du manteau reçoit son inflexion du col, laquelle inflexion va engendrer une éclosion diffuse de la floralité printanière ; ce qu’Arcimboldo représente là, de manière géniale, c’est la germination avant l’éclosion, la progressive révélation de la fleur épanouie, selon un axe partant du manteau et incitant à l’élévation, c’est-à-dire en partant d’une raideur verticale, et menant celle-ci à l’éblouissement final de la chevelure bouclée où se déploie l’artifice chromatique.
Comme pour mieux accompagner cette élévation symbolisant l’éclosion du cycle, Arcimboldo hiérarchise ses couleurs, et établit une transition extrêmement subtile, du bas de la toile qui est composé de teintes froides, et il réchauffe progressivement celles-ci jusqu’à ce qu’elles adoptent la chaleur vive de la chevelure, extrêmement lumineuse.
Le tableau qui m’a le plus ébloui, c’est très certainement le Libraire ; ce doit être mon côté classique qui me le fait aimer car le Libraire est composé de la plus habituelle des façons ; construction pyramidale, inscrite dans l’ovale, avec point de fuite unique, respect de la composition en tiers, tout concourt à faire de cette œuvre une banale application des règles classiques. Et pourtant… Quelque chose comme du cubisme se joue ici – et l’on sait combien compte dans une œuvre le fait qu’elle préfigure quelque chose pour que les doctes daignent y accorder quelque intérêt –, si bien que le plus déroutant pour l’époque prend appui sur le plus classique. Mais il faut aller bien plus loin : toute l’œuvre est conçue comme une permanente opposition. La construction cubique du visage et le cadre classique de sa structuration, mais aussi les lignes de force qui à la fois se règlent sur la verticalité rigide des livres disposés debout et se distordent avec les plis du rideau au second plan, de telle sorte que rentrent en conflit l’extrême raideur du premier plan et la plasticité souple du second. L’œil se trouve ainsi obligé de passer d’un plan à l’autre, et de créer lui-même le mouvement, grâce à cette opposition subtile. Chromatiquement, l’opposition est également manifeste : on observe deux harmonies analogiques où se mêlent couleurs chaude et froide.

Tout concourt ainsi à faire de ce tableau une fantastique synthèse, une conciliation des contraires, dont le summum me semble être le livre ouvert, tenant lieu de chevelure, mais ouvert sans qu’il n’indique de page précise ; il me semble que ce livre ouvert est fondamental dans l’économie de l’œuvre : symbole évident de la connaissance, il déstabilise aussitôt l’idée de connaissance figée et précise grâce au fait qu’il n’ouvre sur aucune page en particulier ; il est ouvert comme s’il était feuilleté et non lu ; certes, cela a un sens plastique car il s’agit de mimer la chevelure mais je crois que se joue aussi le refus de la fixité, que l’on retrouvait dans l’opposition plis du rideau / verticalité des lignes des livres. Tout ici est mouvement et contradiction : cela semble fixe mais rien n’est plus animé.
Enfin, et puisqu’il me faut faire un choix drastique parmi les dizaines d’œuvres présentées, je retiendrai le Jardinier, qui nous a fait penser à Louis-Philippe en raison de la proximité avec la poire qu’il évoquait. La particularité de ce tableau est qu’il peut se voir des deux côtés : de l’un il représente un jardinier, de l’autre un plat de fruits. L’effet est tout à fait saisissant, et encore une fois il est intéressant de regarder précisément comment Arcimboldo s’y est pris plastiquement. Je crois que ce tableau en particulier, et la série de toiles équivoques qu’a réalisée Arcimboldo, exprime de façon presque caricaturale l’idée que Berni avait développée contre Pétrarque, à savoir celle du renversement. « La technique, écrit Pinelli, est celle du renversement, fondée sur le calque « à l’envers » de l’original. »[2] Le programme est certes littéraire mais il ne fait aucun doute qu’Arcimboldo le fait sien, en le radicalisant : non seulement il inverse l’original, mais de surcroît il rend indécidable l’original et le renversement ; est-ce en effet le portrait qui renverse le pot de fruits et légumes ou le pot qui est renversé par le portrait ? Nul ne le sait, quoique des deux possibilités, ce soit le portrait qui tire vers le grotesque et qui, à ce titre, semble subvertir le plat qui demeure extrêmement figuratif…

La structure de l’œuvre, à l’instar du Libraire, est construite selon la fameuse règle des tiers, ce qui revient à dire qu’il est structuré selon 9 rectangles égaux (une sorte d’ennéade rectangulaire). Mais quel peut être le concept de lignes de force lorsque l’œuvre est réversible ? La question, pour être franc, ne m’était jamais venue à l’esprit avant que je ne voie ce tableau ; jamais je ne m’étais dit qu’une ligne de force pouvait être réversible ; comment Arcimboldo a-t-il résolu la question ? Je crois qu’il a conçu la toile de telle sorte que du côté des légumes et des fruits, on ait une impression de surgissement, d’érection si je puis dire où chacun des légumes se trouve turgescent ; mais inversement, si l’on retourne le tableau, on voit un homme pesant, dont Arcimboldo a justement dû prévoir la justification ; je veux dire par là qu’il fallait que soit justifiée plastiquement la pesanteur du visage, en raison même de l’élévation des légumes – cette phrase, sortie de son contexte, serait ridicule… Je crois qu’Arcimboldo a donc justifié cette pesanteur par un élément fondamental et extérieur aux lignes de force, les deux gigantesques gousses d’ail. Il me semble évident que celles-ci n’ont de sens que pour le visage, auquel elles confèrent la justification nécessaire d’un homme gros et joufflu, dont se déduira fort logiquement une impression de lourdeur, de pesanteur et donc de tension vers le bas, conséquence exacte de la traction aérienne des légumes érigés.
Seulement Arcimboldo reçoit une nouvelle contrainte plastique ; sous peine d’alourdir son œuvre, il ne peut pas éclairer cela même qui, dans le sens du portrait, indique la pesanteur. Que peut-il donc décider ? Quelles sont les zones qu’il peut éclairer ? Celles qui ne sont pas susceptibles d’indiquer une quelconque lourdeur, dans l’un des deux sens. Ce sont donc les deux gousses d’ail qui vont recevoir l’essentiel de la lumière car en elles se jouent à la fois la neutralité des graves et la justification de la rotation. Eclairer les gousses / joues, je crois que c’est donc la possibilité exclusive qu’il reste à Arcimboldo pour que son tableau demeure gracieux.
Il y aurait évidemment mille choses à dire encore sur cette belle exposition, sur le maniérisme d’Arcimboldo, sur la coloration politique également de ses œuvres. Mais j’en ai peut-être trop dit et ne saurais que trop engager à découvrir cette belle exposition au Luxembourg, nonobstant le fait que le Sénat paye les collections qu’il emprunte et que cela irrite quelque peu une admirable connaissance…
[1] Antonio Pinelli, La belle manière, LGF, 1996, p. 212
[2] Ibid. p. 211